« Accusé boomer, levez-vous. » Le jour où j’ai compris s’adresse aux jeunes générations et leur explique la façon de voir les choses (et la façon de vivre) de jeunes boomers au cours des décennies passées. Bruno David retrace l’histoire des enjeux environnementaux et celle de sa prise de conscience de l’auteur.

Dans les années 1960 – 1970
Le progrès primait sur tout, des esprits avisés pouvaient pourtant s’inquiéter de la pollution et certains le faisaient. Ces années-là ont été marquées par des marées noires, Le Torrey Canyon en 1967 sur les côtes britanniques et françaises, L’Amoco Cadiz en 1978 sur les côtes bretonnes, une des pires catastrophes écologiques de l’histoire. Des dizaines de milliers d’animaux périssent. Le naufrage signe le début de prise de conscience de la population, mais il est toujours question de pollution, pas de climat. Et pour cause, les vagues de froid se succèdent pendant les hivers. Quant à la biodiversité, il suffit de songer au succès du film Le monde du silence (Jean-Yves Cousteau). Il a reçu l’Oscar du meilleur documentaire en 1957. Aujourd’hui, la scène de massacre des requins, ainsi que quelques autres sont inacceptables.
Quatre ans auparavant, René Dumont, premier candidat écologique à la présidence de la République, avait pourtant envisagé l’éventualité du changement climatique. Il était passé pour un original, n’avait recueilli que 1,32 % des voix.
À la fin des années 1970, la préoccupation environnementale majeure : la pollution. Qu’en sera-t-il des années suivantes ?
« Si vous pensez que je focalise trop mes propos sur la pollution, c’est un regard du XXIe siècle. Quarante ans en arrière, c’était mon sujet de préoccupation environnementale, même si, pour être tout à fait honnête, d’autres signaux commençaient de m’alerter. »
Dans les années 1980
Les catastrophes écologiques continuent, en 1984, une usine qui produit des insecticides prend feu en Inde à Bhopal. En 1989, l’Exxon Valdez échoue sur les côtes de l’Alaska.
« Toutefois, on ne parle pas de biodiversité, le vocable n’étant pas encore sorti de l’ombre, mais d’espèces, d’écosystèmes, de biosphère. Peu importe les termes, me direz-vous, quoique… »
La décennie 1990, période de transition
Le terme biodiversité est mis en avant lors du premier sommet de la Terre en 1992. Il suscite de l’émotion.
Pendant ce temps, le trou d’ozone, la crise de la vache folle, le SIDA, encore une marée noire, celle de l’Erika, sont des signes avant-coureurs que l’activité humaine modifie notre environnement. Sans oublier la grande tempête de 1999.
À la fin des années 1990, la prise de conscience de Bruno David est aboutie, mais ce n’est pas le cas de ses amis, non plus que l’homme de la rue.
La canicule de l’été 2003
Cet été-là, 15 000 personnes sont mortes de chaleur en France (et il a fallu un petit moment pour prendre conscience du problème). Le nouveau millénaire signe l’augmentation des hivers doux et des étés caniculaires :
« Les dix années les plus chaudes enregistrées depuis 1880 sont toutes postérieures à 2005 et les huit plus chaudes sont les huit dernières. » p103
Il signe aussi l’apparition d’espèces exotiques envahissantes aussi (frelon asiatique, moustique tigre).
Le GIEC
Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) naît en 1988 et publie son premier rapport en 1990. Le premier rapport constate que l’effet de serre impactera le climat et que la hausse des températures pourrait atteindre 3° en 2100. Les termes seront toutefois mesurés et prudents.
Le deuxième rapport, publié en 1995, confirme ces tendances, toujours avec mesure et prudence. Quant à l’homme de la rue, il vit des hivers très froids, même si les épisodes de canicule deviennent plus nombreux.
Le troisième rapport est édité en 2001, cette fois-ci avec moins d’incertitudes : le réchauffement climatique sera supérieur à ce qui a été prévu, et oui, ce sont bien les activités humaines qui en sont la cause.
J’ai regretté que Bruno David ne fasse pas l’historique de la diffusion des rapports du GIEC ; si aujourd’hui, les conclusions de ces rapports sont largement diffusées, il ne me semble pas que c’était le cas au début de sa création.
La polémique : boomers vs millenials
En conclusion, Bruno David passe en revue la façon de vivre des boomers et celle des millenials. Certes, il y avait peu ou pas du tout de prise de conscience de la part des premiers, et leur niveau de vie est meilleur aujourd’hui que celle des nouvelles générations. Ils n’étaient pourtant pas, au même âge, dans une si grande frénésie de consommation, ne serait-ce parce qu’une foule de choses n’existaient pas (déplacements en avion très abordables dans les années 2000, nouvelles technologies…).
Est-ce que comme moi, vous pouvez vous souvenir d’un évènement qui vous a fait comprendre ?
Et si vous ne l’avez pas lu, je vous recommande son livre : À l’aube de la sixième extinction pour mieux comprendre les enjeux de la biodiversité.
Mon avis en résumé
Écrit pour la nouvelle génération, celle qui suit Greta Thunberg (Les scènes du cœur), mais aussi de quoi réfléchir pour les moins jeunes.
Ma note : 4,9/5
Lecture un peu exigeante
Un des meilleurs livres du moment (2023)
À vous maintenant
Vous l’avez lu ? Donnez-moi votre avis en commentaires. Pensez à activer la cloche qui se situe avant le bouton Publier le commentaire pour recevoir un mail avec les réponses à votre commentaire.
Acheter neuf
Ce livre vous tente ? Achetez-le neuf grâce au lien ci-dessous. Lien affilié, c’est-à-dire que si vous achetez après avoir cliqué sur ce lien, je toucherai une commission (sans coûts supplémentaires pour vous).
Parlons encore écologie
Impact
Olivier Norek
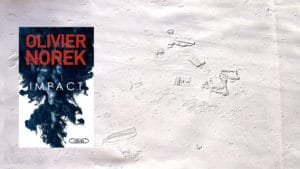
Le règne du vivant
Alice Ferney

Info-livre : Le jour où j’ai compris par Bruno David
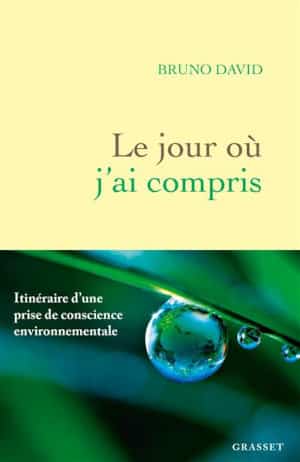
Editeur : Grasset
ISBN : 978-2-246-83290-4
Pages : 135
Date de parution : 10/05/2023
Restons en contact
Inscrivez-vous à la newsletter
